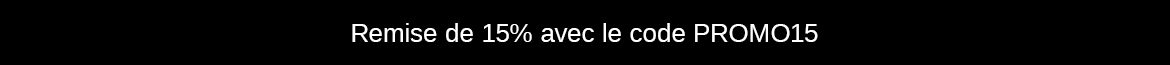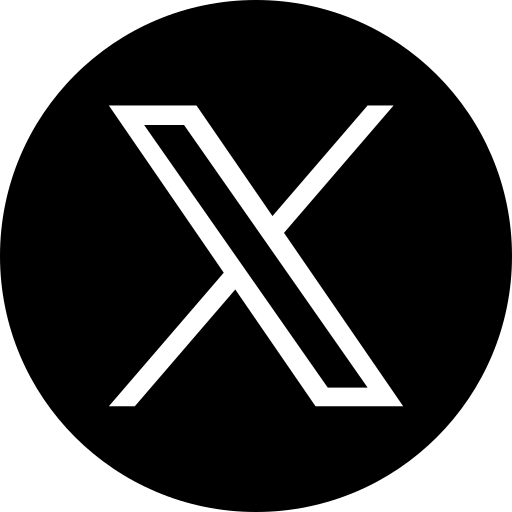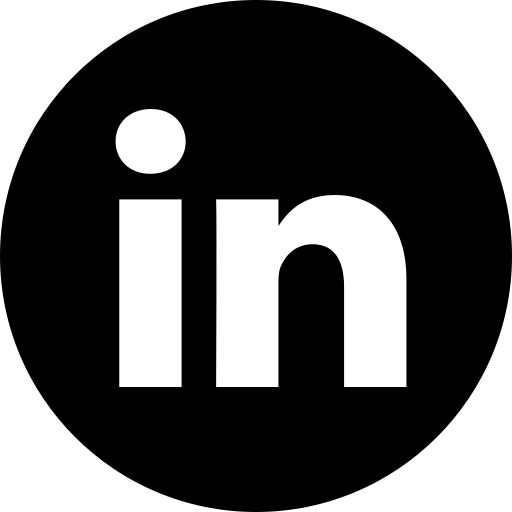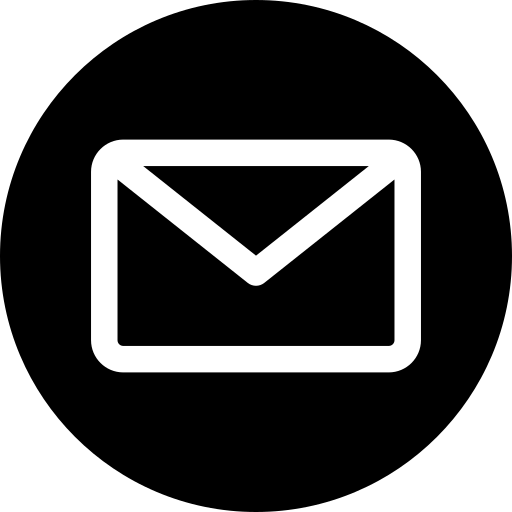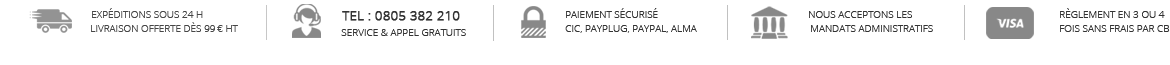Lorsqu’on investit dans du matériel professionnel, on s’attend à ce qu’il fonctionne correctement et durablement.
Mais parfois, un vice caché se révèle après l’achat, rendant l’équipement inutilisable ou réduisant considérablement son utilité pour l’acquéreur. Cet article explique en détail la garantie légale des vices cachés entre professionnels : sa définition juridique, ses conditions d’application, les délais pour agir et le rôle des clauses contractuelles, pour sécuriser les transactions commerciales.
Définition juridique et régime des vices cachés
La garantie légale des vices cachés, prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil, protège l’acheteur contre les défauts invisibles présents avant la vente. Entre professionnels, ce régime s’applique intégralement, même si les parties peuvent l’adapter contractuellement en fonction des usages du secteur.

Définition juridique et conditions d'application
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur contre tout défaut caché qui rendrait l’objet inutilisable ou diminuerait tellement sa valeur que l’acheteur n’aurait pas conclu l’achat, ou aurait négocié un prix inférieur.
Cette garantie légale s’applique automatiquement, même si le vendeur ignorait le vice au moment de la vente.
- Défaut antérieur : le vice doit exister lors de la livraison et ne pas résulter d’une usure normale ou d’une mauvaise utilisation.
- Caractère caché : une inspection minutieuse par un professionnel compétent ne permettait pas de le détecter.
- Gravité suffisante : le défaut rend le bien inutilisable ou réduit fortement son utilité au point que l’acheteur aurait renoncé à l’acquérir.
- Absence de faute de l’acheteur : une utilisation inappropriée ou un mauvais entretien excluent la garantie.
Prenons l’exemple d’une plastifieuse professionnelle : si une fissure interne cause des dysfonctionnements répétés malgré une installation correcte, il s’agit bien d’un vice caché. Il en va de même pour un rouleau chauffant mal assemblé, à condition que le problème existait avant la vente et était impossible à détecter lors de la mise en service.
La Cour de cassation précise que ces conditions s’appliquent à tous les biens, neufs ou d’occasion. Elle tient compte des compétences techniques spécifiques de l’acheteur professionnel pour apprécier si le vice était réellement caché.
Garantie des vices cachés et action possible
Face à un vice caché, l’acheteur a le choix entre deux actions : demander l’annulation de la vente (action rédhibitoire) ou une réduction du prix (action estimatoire), conformément à l’article 1644. Cette décision revient entièrement à l’acquéreur, sauf clause contraire clairement acceptée entre professionnels.
Dans les faits, une réparation ou un échange est souvent privilégié pour maintenir la relation commerciale. Cependant, si le vendeur connaissait le vice et l’a volontairement caché, l’article 1645 permet à l’acheteur d’obtenir une indemnisation couvrant tout son préjudice.
Clause d'exclusion entre professionnels
Les professionnels peuvent limiter ou supprimer la garantie légale des vices cachés par une clause spécifique, à condition que l’acheteur évolue dans le même secteur et ait donné son accord en pleine connaissance de cause, comme le rappelle la Cour de cassation.
Cette clause doit être formulée de manière claire et précise, et portée à la connaissance de l’acquéreur avant la signature du contrat. Une mention ajoutée après coup sur une facture n’est généralement pas valable.
Contentieux et preuve en pratique
C’est à l’acheteur de prouver le vice caché : il doit démontrer son existence, son antériorité et son caractère caché par tous moyens, souvent via une expertise. Les rapports techniques, photos datées, échanges écrits et bons de livraison constituent des preuves essentielles.
Dès la découverte du vice, il est crucial de cesser d’utiliser le bien, de le conserver intact et d’informer rapidement le vendeur par lettre recommandée, en joignant un rapport d’expertise pour préparer une éventuelle action en justice et limiter les litiges.
Foire aux questions
Dans les relations entre professionnels, le délai pour intenter une action en garantie des vices cachés est de deux ans à partir de la découverte du vice. Ce délai s'ajoute à la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil. L'acquéreur dispose donc d'un maximum de sept ans après la vente pour agir, à moins que les parties n'aient convenu d'une clause limitant expressément ce délai - auquel cas la charge de la preuve devient plus lourde pour l'acheteur.
La Cour de cassation reconnaît la validité des clauses d'exclusion ou de limitation de la garantie des vices cachés dans les contrats entre professionnels, sous trois conditions : les deux parties doivent exercer la même activité, la clause doit être formulée de manière très claire, et l'acquéreur doit l'avoir expressément acceptée. Cependant, cette exclusion ne s'applique pas en cas de dol (si le vendeur professionnel connaissait l'existence d'un vice mais l'a caché), où sa responsabilité reste pleinement engagée.
Pour établir la présence d'un vice caché, trois éléments doivent être prouvés : que le défaut existait avant la vente, qu'il était indécelable lors de l'achat, et qu'il rend l'équipement impropre à son usage. La meilleure approche consiste à :
- Conserver le matériel en l'état dès la découverte du vice
- Rassembler tous les documents techniques et photographies
- Demander un rapport d'expertise ou un devis de réparation
Ces preuves techniques sont essentielles pour la mise en œuvre efficace de l'action en garantie.